«J’avais onze ans, mais je ne m’intéressais que vaguement à ce qui se passait dans le monde, parce mon monde à moi, le seul qui comptait vraiment, c’était le baseball.»
- John Grisham, Calico Joe
«Le baseball, c’est pas pour n’importe qui, mon fils.»
- -Michel Filteau
Je dois raconter cet épisode surnaturel survenu le 27 juin 2018 au Fenway Park de Boston. Juste avant, les Red Sox avaient bousillé une solide avance de 6-0, en cinquième manche, principalement en raison du manque de sang-froid de son releveur au caractère irascible, Joe Kelly, membre en règle de son propre fight club, après avoir instigué une mêlée générale contre les Yankees, plus tôt cette saison. Plusieurs considèrent ce moment comme le point de résurrection de la rivalité Red Sox-Yankees, comme si cette dernière était morte dans un passé rapproché, mais cela est l’objet d’une toute autre histoire. À vrai dire, le baseball, comme tout bon mythe américain, fait parfois appel à un contre-mythe pour justifier son existence de temps à autre, quitte à déclarer cliniquement morte sa plus grande rivalité, pour ensuite mieux la ressusciter. Mais là, je m’égare encore une fois. Je dois m’en tenir à l’essentiel : raconter l’épisode «surnaturel» de cette jeune fille qui, le temps de quelques manches, s’est transformée en coryphée de nos aspirations les plus tragiques. Une véritable histoire de baseball, au fond. Une histoire qui fait appel à la «transfiguration du banal», à l’apothéose de la nonchalance qui soudainement se métamorphose en vigueur de l’esprit, dans la sublimité d’une balle qui disparaît quelque seconde dans l’éclat des projecteurs lumineux d’un stade centenaire.
Laissez-moi vous expliquer : quand les Angels de Mike Trout – une équipe dont le sort malheureux est décidé depuis le mois de mai – sont parvenus à niveler à la marque à 6-6, suite à une série d’erreurs dignes de celles qui s’observent quotidiennement dans le stade des Bulls de Durham, une jeune fille s’est mise à chanter. En fait, elle scandait plutôt un traditionnel Let’s go Red Sox !, soutenue par une métrique parfaite, au point où nous croyons qu’un enregistrement sonore était diffusé dans des haut-parleurs cachés dans les poutres du Fenway. Mais non, une jeune fille pleine de vie était bel et bien là, à quelques gradins d’où j’étais assis, en diagonale du marbre. Elle gardait espoir, elle chantait de toutes ses forces pour que son équipe ne succombe pas à leur impuissance du moment. Sous les applaudissements acharnés des partisans réceptifs à sa petite scansion aigue, son chant est devenu une prière. D’ordinaire, on revient rarement d’une telle chute. Les Red Sox se sont mis à frapper. Ils ont placé deux hommes sur les sentiers. Et subitement, le ciel s’est déchargé d’une pluie intense sur la pelouse du Fenway. Tout comme l’ondée, le chant de la jeune fille ne tarissait pas. Nous étions en plein cantique d’été. Let’s go Red Sox ! Et nous lui répondions, même si l’envie de nous reposer la voix nous prenait parfois. Il fallait continuer, ne pas laisser tomber le chant de la jeune fille que son père soulevait comme un totem bariolé dans les moments de haute tension. Let’s go Red Sox !
Quelque chose de l’ordre d’une ancienne superstition bien plus vieille que nous se produisait. Nous n’étions plus en maîtrise du moment. Notre chant commun rejoignait celui des ancêtres, de tous ses fantômes des années 1940, ceux qui n’ont jamais vu leur équipe remporté un championnat en 86 ans, ceux-là mêmes qui ont aidé les Red Sox à conjurer la malédiction du Bambino en 2004. Ils chantaient à travers nous. Après tout, si l’on remonte aux origines étymologiques du mot superstition – supertitio : ce qui perdure des âges anciens – nous donnions raison à ceux qui affirment que le baseball est le plus superstitieux de tous les sports. Et au bout de deux manches à scander inlassablement Let’s go Red Sox !, Rafael Devers a frappé une flèche au champ centre-gauche pour faire revenir deux hommes à la maison. À partir de là, la section du Fenway où j’étais assis ne regardait plus le match. La jeune fille-totem eut droit à une ovation de 5 minutes. Nous l’applaudissions tous, presque au bord des larmes. À nos yeux, elle était la seule responsable de cet exaucement qui légitimait la croyance dans les superstitions providentielles du baseball. En toute franchise, connaissez-vous un autre sport où des adultes d’une cinquantaine d’années désignent une jeune fille comme la responsable d’une action surnaturelle provoquant la victoire de leur équipe bien-aimée ?
Cela dit, écrire sur le baseball est une chose certainement intimidante. Comme il s’agit, selon l’avis de plusieurs, du sport le plus littéraire qui soit, cela revient à se mesurer pratiquement à un genre littéraire en soi, sinon un sous-genre, qui comporte une riche tradition et une historicité textuelle de grande envergure. On ne parle jamais seul lorsqu’on écrit sur ce sport. Non seulement les lecteurs de baseball ont-ils tout lu les textes inimaginables sur ce dernier – The Natural, Hub fan big kid adieu, Shoeless Joe, les livres de Robert Creamer, le documentaire de Ken Burns, Fathers playing catch with sons de Donald Hall et plus récemment, De l’utilité de l’ennui d’Andrew Forbes –, ce qui nous expose aisément au risque de répéter des choses connues de tous depuis fort longtemps, mais il devient difficile de se départir de la peur même de paraître pour un imposteur s’improvisant écrivain de baseball. L’objet littéraire du baseball est une vache sacrée. Il suffit de lire ne serait-ce qu’un article de Grantland Rice – ou la pléthore d’écrivains et de poètes qui sont intervenus dans le Baseball de Ken Burns – pour comprendre combien la parole du baseball est ancienne, que son archaïsme n’est au fond que le produit d’une longue patience littéraire, celui d’une attention ancestrale portée envers ce sport depuis près de deux siècles qui le rapproche davantage de Leaves Of Grass que de la furtivité instrumentale de la société spectaculaire du 21esiècle.
Or, à notre époque de grande amnésie collective, peu de gens peuvent apprécier ce sport qui appartient résolument à un autre temps, ces rituels de lenteur et de flegme proportionné qui sont en totale contradiction avec ceux de notre siècle qui ne tolère plus l’ennui et la contemplation, deux éléments essentiels à l’appréciation du baseball, ce sport qui confère au temps une valeur formelle, cet «art du temps» comme l’écrit Samuel Archibald dans son essai «Put me coach, I’m ready to play !» Son principe temporel, comme je me plais à le dire, est celui de l’éternité. Dans l’absolu, un match de baseball pourrait ne jamais se terminer. Toute la logique narrative du roman Shoeless Joede William Kinsella – et de son adaptation cinématographique Field of Dreams – repose d’ailleurs sur un match de baseball enfermé dans les limbes spectraux de l’histoire, un match qui perdure depuis plus de 70 ans. Ce qui signifie qu’une équipe de baseball victorieuse ne fait pas seulement remporter une rencontre, elle empêche l’éternité de se produire. Je reviens à la charge : connaissez-vous un autre rituel semblable dans le monde, où chaque soir, c’est-à-dire 162 fois par année et davantage si on inclut les séries mondiales, des hommes empêchent l’éternité d’envahir un petit territoire en forme de losange débouchant sur la porte céleste où reposent les fantômes oubliés du baseball ?
Tout près de moi, la jeune fille-totem du Fenway Park chantait pour entraver le poids de l’éternité. Elle n’était plus qu’une voix, la véritable «voix de Dieu» – et non celle de Bob Sheppard, le mythique annonceur des Yankees, aujourd’hui décédé – se manifestant dans celle d’une enfant encore épargnée par le désenchantement et l’amertume des prises de conscience qui viennent avec la vie adulte. Son éternité à elle, c’est justement l’enfance du monde, celle à laquelle la Bible consacre ce passage précédant la chute de l’homme dans le monde de la conscience malheureuse et de la communauté des mortels, ce temps de l’innocence que le baseball est le seul à pouvoir ressusciter, cet Éden violent de l’enfance, pour reprendre le titre du magnifique roman de Bernard Blangenois. Elle ne sait pas que la victoire des Red Sox est la pire chose qui pourrait nous arriver, ce soir. Elle ne réalise pas que tant et aussi longtemps que la rencontre se poursuit, que tant et aussi longtemps que nous demeurerons assis à nos sièges, nous n’aurons pas à quitter cette apesanteur qui nous protège de la mort et du temps perdu. Pendant un match de baseball, nous ne retrouvons pas seulement notre propre enfance, mais celle de l’histoire et de l’Amérique elle-même. Nous sommes à nouveau dans le «Premier jardin». Ce n’est pas pour rien que les premiers stades de baseball portaient régulièrement le nom de Garden. Voilà, vous l’aurez compris, je suis croyant, mais je ne vais que très rarement à l’église. Je préfère les stades de baseball, surtout le Fenway Park, les seuls endroits où, hormis là où se produisent les grandes rencontres amoureuses, la dimension surnaturelle de la vie demeure intacte.
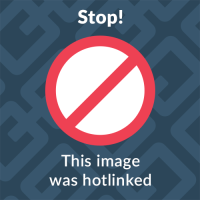









Commentaires
Aucun commentaire