Ce texte est un exercice d’admiration. Il s’adresse aux croyants du sport, ceux qui croient que les choses ont une âme, une essence. John Madden vient de mourir et, pour ses admirateurs, sa perte nous renvoie à l’âme du sport qu’il aimait tant, à sa dimension la plus brutale (forcément sacrée), ce lieu où tout se décide au football : la ligne de mêlée. Ce Pantagruel californien a connu son baptême du Gridiron comme joueur de ligne offensive. C’est depuis cette expérience des tranchées (l’âme du football) que la personnalité de John Madden s’est forgée. Il existe, d’ailleurs, une séquence d’archive célèbre de NFL Films où l’on voit Madden pousser de vieilles sleds métalliques sur lesquels se fracassaient les joueurs de ligne des Raiders d’Oakland, durant les séances d’entraînement. Ce rituel exténuant, Madden l’avait surnommé le Back-Breaker-Drill. C’est précisément cette épreuve d’endurance qui donne au football son sens : celui d’une flagellation volontaire, dans laquelle l’homme se mesure à une chose beaucoup plus intimidante que la pesanteur d’une structure métallique ; le véritable adversaire, c’est l’homme lui-même, sa propre fatigue, celle qui fera de lui un «lâche», une «poule mouillée», s’il succombe au murmure de sa faiblesse. Madden se plaisait à décrire cet exercice comme le meilleur remède contre les lendemains de virées nocturnes.
John Madden fut un pont entre les époques. Quelque part, durant les années 1960, il s’était inscrit à un séminaire de Vince Lombardi, son idole, car il caressait le rêve de devenir entraîneur dans la NFL. Comme bien des jeunes hommes dans la vingtaine, Madden se considérait comme un prodige, puisqu’il pouvait discuter des subtilités d’une stratégie particulière pendant, au moins, cinq minutes. Lors de ce séminaire, Lombardi a consacré plus de huit heures d’enseignement au Power Sweep, le jeu fondamental de son système offensif. C’est à ce moment précis que John Madden réalisa que la connaissance du football américain constitue un apprentissage à jamais inachevé, et fragmentaire. Comme toutes les grandes disciplines, celles avec des maîtres et des écoles de pensée, personne ne maîtrise ce sport à la perfection. À chaque jeu, quelque chose nous échappe : le positionnement d’un maraudeur, l’angle du bras avec lequel le quart-arrière distribue le ballon, le mouvement de cheville d’un joueur de ligne offensive, et j’en passe.
Ces formes d’art (le football en est une) sont toutefois des portes vers ce lieu abstrait qu’on nomme l’éternité, présent en chacun de nous, puisqu’il constitue, en vérité, notre mémoire commune et personnelle. John Madden est entré dans ce royaume de son vivant, en demeurant, comme ses joueurs l’ont attesté, un coach fidèle à son identité profonde, celle d’un gaillard emporté, jovial, compatissant, très intelligent, et affectueux. Sa plus grande réussite professionnelle est probablement d’avoir su diriger – et inspirer – les athlètes rebelles des années 1970 (Kenny Stabler, le Waylon Jennings de la NFL), sans verser dans la sévérité militaire de Vince Lombardi, et de remporter un Super Bowl avec eux. «C’est en demeurant soi-même qu’on obtient le respect des gens», répétait souvent Madden. Les Raiders de cette époque étaient des hors-la-loi, ils ne respectaient personne, hormis Al Davis (le outlaw absolu), et John Madden.
Le coryphée des salons américains
Il est difficile d’écrire sur des hommes qui viennent de mourir. La pudeur s’impose devant une vie que nous ne connaissons que par récits interposés. De John Madden je ne connais rien de plus que vous. J’ai été témoin, comme tant d’autres nord-américains de sa vie publique. Il a été l’une des voix marquantes de mon enfance. C’est d’ailleurs à cette réalité que nous confronte la vie et la mort de John Madden : qu’est-ce qu’une voix? C’est par sa voix qu’il a accédé à l’immortalité des images ; alors que son corps glorieux et carnavalesque, celui qui incarnait le repas sacrificiel de l’Action de Grâce pour les familles nord-américaines, vient de nous quitter. Pour les téléspectateurs du Super Bowl XXVI (le premier que j’ai regardé dans ma vie), c’est la voix de John Madden qui accompagnait Tom Brady, avec 1 minutes et 17 secondes à faire au quatrième quart, dans sa marche vers son destin, celui du plus grand quartarrière de tous les temps, alors que personne, sauf Bill Belichick, ne croyait en lui. Madden priait les Patriots d’écouler le temps restant et de se rendre, en sécurité, au quart supplémentaire. Belichick et Brady lui ont désobéi. Après une montée improbable du terrain, au moment où Adam Vinatieri foulait la pelouse artificielle du Superdome pour effectuer le botté de 48 verges qui permettrait aux Patriots de remporter le premier Super Bowl de leur histoire, devant les 86.8 millions de spectateurs de FOX, Madden prononçait le plus sincère des mea culpa : What Tom Brady just did gives me goosebumps. Cette phrase résonnera à jamais dans la mémoire du football américain. L’honnêteté de John Madden fut son trait de caractère le plus distinctif, la raison pour laquelle les gens, que ce soit le Président des États-Unis ou l’ouvrier des usines Ford, rêvaient de boire une bière avec lui, en discutant du match en cours.
Depuis la mort de John Madden, de nombreux témoignages, venant de gens ordinaires et de membres des médias, racontent à peu près la même chose : des dimanches après-midi passés en famille, avec les voix de Madden et de Pat Summerall, son légendaire acolyte décédé en avril 2013, comme bruit de fond. Pour les Québécois, bien que présent depuis plus d’un siècle sur notre territoire, le football n’est pas notre sport national. Il ne soulève pas les familles de leur fauteuil, comme un but marqué par le Canadien de Montréal. Chez-nous, le football occupe une autre fonction que celui de tissu social (rôle réservé au hockey, ce sport inventé sur nos lacs gelés en hiver), il nous renvoie à la partie de nous-même qui habite en dehors des frontières du Québec, c’est-à-dire à notre américanité. Pour bien des familles québécoises, la voix de John Madden était associée à ce rituel dominical païen, à travers lequel notre peuple observait la grandeur d’un autre peuple, celui-là protestant et s’étant affranchi de la tutelle britannique, une quinzaine d’années après la conquête de la Nouvelle-France. Le football n’est pas notre sport, donc, et, pourtant, nous reconnaissons quelque chose en lui que nous voudrions être. Je crois que, pour bien des Québécois, John Madden incarnait cette aspiration du rêve américain, auquel ils ne peuvent participer pleinement : cette voix chaleureuse d’un homme franc, libre, décomplexé de sa taille gargantuesque, et qui incarne la passion inépuisable, profondément américaine et protestante, pour cette chose, parfois cruelle, qu’on appelle la compétition. Madden parvenait à humaniser cet art de la guerre qu’est le football, cette consécration belliqueuse devant le spectacle du monde. Il possédait, surtout, cette capacité inouïe d’expliquer des réalités abstraites de ce sport, aussi complexe que les échecs, dans la langue des brasseries et des usines.
Pour les gens de ma génération, nous avons brièvement connu John Madden l’analyste de matchs. Nous nous souvenons principalement de son visage sur la couverture du jeu vidéo d’EA Sports qui porte son nom. Grâce à ce jeu, sa voix tonitruante et ses formules exubérantes préenregistrées (BOOM! HE HIT HIM LIKE A TRUCK!), faites sur mesures pour les salles d’arcades, nous avons développé une sorte d’intimité avec les icônes de la NFL. Qui ne s’est pas pris pour Michael Vick pendant la saison 2004 de la NFL? Et même après? Je connais des gens qui jouent encore à Madden 2004 sur leur vieux Playstation II. Jamais nous n’avions «contrôlé» un athlète aussi dominant que lui (Michael Vick) sur nos consoles, à part, peut-être ceux nés dans les années 1970, le Bo Jackson de la période Sega. John Madden a fait entrer la NFL dans nos maisons, elle est devenue, grâce à lui, un repère déterminant dans l’espace-temps de notre mémoire. Mon beau-frère (qui n’est pas le plus grand des amateurs de football) m’a écrit, le jour de la mort de Madden, pour me dire que nous venions de perdre un grand homme, la voix de ces après-midis entre chums, avant que la vie fasse de nous des hommes responsables et occupés ; des pères de famille, pour les plus matures d’entre nous.
Quand les hommes comme John Madden meurent, ce n’est pas un homme qui disparaît, c’est un morceau d’époque irremplaçable, un creuset humain de valeurs et de souvenirs. Je n’ai pas connu l’Amérique des années 1980, bien qu’elle hante presque tout ce que j’écris. C’est à travers des figures qui l’incarnent que j’ai réussi à effleurer quelque peu son âme. J’explore ces sensations diffuses de la nostalgie. Elles me procurent cette illusion, inespérée, de remonter les corridors du temps, d’accéder à une époque mythifiée qui précède venue au monde. J’y retrouve l’Amérique de Poltergeist, celle de la fin de la Guerre Froide, des premiers centre commerciaux, dans ces parties archivées, où John Madden envahit l’image des tracés de son crayon numérique (j’ignore comment décrire cet objet autrement).
Madden est le vestige d’une époque où l’on croyait encore que le meilleur était à venir, qu’avec l’effort et la ténacité, on peut tout accomplir ; le vieux mythe du rêve américain, auquel plus personne ne croit. Nous savons désormais, grâce à l’Histoire, que les rêves promis par la NFL sont des mirages, que Madden fut une exception (comme toutes les stars du football), que la grande majorité des gens ne font pas ce qu’ils veulent dans la vie. Pourtant, John Madden offrait à ces hommes assis au bar, à ces familles réunies dans le salon pour la Thanksgiving, l’espoir que certains rêvent peuvent se réaliser : celui de gagner sa vie en parlant de football, de voyager à travers l’Amérique dans un énorme autobus quand on a une peur morbide de l’avion, de remporter le Super Bowl, d’être intronisé au Temple de la Renommée du football à Canton, d’être aimé de tous. Pour cela, et tant d’autres choses, John Madden fut l’une des plus belles exceptions du 20e siècle.
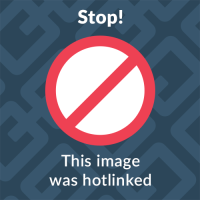









Commentaires
Aucun commentaire