À feu Michel Grégoire (1962-2008)
3 Février 2002. Nous sommes à quelques semaines de l’ouverture des Jeux Olympiques de Salt Lake City, quelques mois après les attentats du 11 septembre. Comme tous les enfants de mon quartier, je joue au hockey dans le stationnement de mes parents. Mon sort est déjà connu. Je suis l’éternel désigné pour garder les filets, avec mon équipement Road Warrior troué de toutes parts, acheté en spécial chez Canadian Tire. Mon impuissance est toujours la même : les balles de tennis gelées se retrouvent presque systématiquement au fond de la cage. Ces prouesses maladroites provoquent surtout le rire de mes amis et, parfois, leur rage quand nous jouons contre l’équipe de la rue voisine. Cet après-midi, nous avons rendez-vous avec eux. Ils sont plus vieux que nous et jouent pour les Patriotes de Saint-Jean-sur-Richelieu, la crème de la crème du hockey mineur de ma région. Ils se présentent devant nous avec leurs bâtons de hockey haute-gamme – des CCM Vector – et leurs gants neufs en lâchant une boutade du genre : «Comptez-vous chanceux que personne d’autre puisse jouer contre nous aujourd’hui. Vous êtes nos bouche-trous». À ma grande crainte, une balle orange durcie par le froid tombe dans la rue, au moment d’exécuter la mise au jeu. Six minutes plus tard, je n’ai pas arrêté un seul tir et nous tirons déjà de l’arrière 9-0. «Arrête-s’en au moins une sacrement, Vincent !». Rendu-là, je dois être honnête envers moi-même : si mes amis sont la honte du quartier, au hockey-balle, c’est surtout de ma faute. Décidément, je ne suis pas un gardien de but. Je ne serai jamais un gardien de but. Et encore moins un attaquant ou un défenseur.
Trois autres buts plus tard, mes meilleurs amis de l’époque – Shane et Derek – déclarent forfait sans me consulter. Les dignes représentants des Patriotes de Saint-Jean-sur-Richelieu rentrent chez-eux, tandis que Shane et Derek me donnent rendez-vous pour 17h à leur domicile. Comme chaque année, leur père, Michel Grégoire, organise sa traditionnelle soirée du Super Bowl. Et depuis trois ans, à ce moment-là, mon père et moi ne manquons jamais cette kermesse, du moins le début. «Dommage que tu ne pourras pas rester jusqu’à la fin» me dit Derek. Pourquoi les amis sont-ils les premiers à remuer le couteau dans la plaie ? Voici la vérité : à l’âge de dix ans, je n’avais jamais regardé un Super Bowl au complet. Je n’ai jamais vu les vainqueurs soulevés le magnifique Trophée Vince Lombardi. Je n’avais droit qu’à l’extrait syncopé du bulletin des sports le lendemain matin avant de me rendre à l’arrêt de l’autobus scolaire. Chaque année, après le spectacle de la mi-temps, je dois subir l’humiliation devant les autres enfants en permission du dimanche soir. Mon père ne manque jamais à son devoir de père : «Viens-t-en, Vincent. Tu as de l’école, demain». Et sur le chemin du retour, je fais une promesse à mon père : «Si un jour, je deviens Premier Ministre du Québec, une nouvelle journée pédagogique naîtra : le lendemain du Super Bowl. Enfin, la justice règnera. Tous les enfants du Québec pourront regarder le Super Bowl jusqu’à la fin.»
Ce soir-là, avant de quitter la maison, mon père est plus fébrile qu’à la normale, plus souriant. Une minute de marche, à peine, nous sépare de la maison de Shane et Derek. Nos bottes crissent dans la neige folle de février. Mon père enveloppé de son manteau Louis Garneau, vestige des années 1990, rompt le silence et me dit : «On va voir du fun ce soir, mon Vincent !». Je ne lui réponds pas, résigné à mon sort, comme quand je garde le filet contre les Patriotes de la rue voisine, mais ma tête se remplit du vacarme de la sainte-colère des enfants qui ne peuvent jamais regarder le Super Bowl jusqu’à la fin. Et en cette fête continentale du football, je remarque une chose assez curieuse : il n’est plus nécessaire de cogner avant d’entrer chez les gens. Mon père, un homme timide, qui, généralement, tient mordicus aux signes de politesse, entre maintenant chez son voisin comme dans un moulin, en saluant bruyamment la compagnie. Il se passe quelque chose. Je ne reconnais plus mon père. Pourtant, il n’a encore rien bu – il ne boit jamais plus que deux bières – et le botté d’envoi n’a même pas eu lieu. Il passe d’un groupe à l’autre pour discuter du match à venir, lui qui ne regarde qu’un seul match par année, le Super Bowl. Et l’insoutenable douleur d’être gêné de ses parents m’envahit. Je ne reconnais plus mon père.
Une vingtaine de minutes passe avant que je décide de m’asseoir beaucoup trop près de la télévision géante au sous-sol. Le gros John Madden – celui dont le visage tapisse la couverture de mon Madden 98, à l’époque – nous explique comment les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont pratiquement aucune chance de battre les Rams de Saint-Louis, les vainqueurs du Lombardi, deux ans plus tôt. Madden justifie cette défaveur principalement en raison de l’inexpérience de leur quart-arrière recrue, un certain Tom Brady. Un choix de sixième ronde au repêchage de l’année précédente, en provenance de l’Université du Michigan. À ce moment précis de ma vie, ces choses-là n’ont alors aucune importance. Tout ce que je sais, c’est que les Patriots n’ont pas de chance remporter le match. Ils sont dans la même position, victimes du même désaveu, que nous lorsque nous affrontons les autres Patriotes. Ceux qui jouent au hockey à Saint-Jean-sur Richelieu. Ceux qui collectionnent les banderoles de champions de tournois régionaux, ceux-là dont les manteaux d’équipe font l’envie de tous les jeunes garçons de mon école primaire. Mais n’est pas un Patriote de Saint-Jean-sur-Richelieu qui veut. Toutes les parties de hockey-balle disputées dans la cour de l’école Saint-Joseph, ou dans les rues de ma ville natale, nous rappelaient la fermeté de cette règle. Pas de pitié pour les underdogs, les chiens de l’enfer indignes qui, l’instant d’un match, ont le droit de rêver, eux aussi. Ils rêvent d’obtenir réparation pour toute la misère endurée depuis des décennies, parfois depuis plus d’un siècle, sans penser, ne serait-ce une seconde, qu’ils méritent quoi que ce soit. Ce qu’ils gagneront, si jamais une telle chose se produit, ils l’auront payé de leur sang, de leur sueur, de leurs os rompus, c’est-à-dire les leurs et ceux des ancêtres qui les ont précédés.
Et puis vient le botté d’envoi du Super Bowl XXXVI. Je n’ai pratiquement aucuns souvenirs réels de ce match. Ceux que j’ai me proviennent probablement de la reprise enregistrée que j’ai regardée, au bas mot, une cinquantaine de fois, des années plus tard. Toutefois, les ingrédients d’un Super Bowl typique des Patriots sont déjà réunis après le premier quart : aucun point au tableau pour les Patriots, des présences brèves sur le terrain de la part de l’unité offensive et des plans rapprochés sur Bill Belichick prenant des notes dans son carnet avec un crayon de plomb. Et contre toute attente, dix minutes avant la fin de la première demie, Tom Brady parvient à inscrire deux passes de touché, donnant une avance de 14-3 aux underdogs absolus du Super Bowl XXXVI. Comme mon père, je suis enjoué par la performance des Patriots. Mais je sais que ce bonheur prendra bientôt fin. Après le concert de quinze minutes du groupe U2, je devrai retourner vers ma chambre, comme le jeune narrateur d’À la recherche du temps perdu, «à contre cœur, contre mon cœur», tandis que se disputera la meilleure partie du Super Bowl. Celle que je rate chaque année, parce que mon père ne déroge jamais à aucune loi. Parce que mon père a décidé que mon avenir entier se jouerait le soir du Super Bowl XXXVI, à raison de quelques heures de sommeil en moins dans mon jeune corps d’écolier de dix ans. Au diable la mémoire précieuse des Super Bowl vécus en direct, aux orties l’Amérique et ses rituels spectaculaires, j’aurais toute ma vie d’adulte pour retrouver le temps perdu ! N’est-ce pas cela que je suis en train de faire en écrivant sur les Super Bowl ratés de mon enfance ? Cette privation d’enfant serait-elle à l’origine de mon désir d’écrire ?
Le spectacle de la mi-temps commence. Bono chante les plus grands succès de son groupe, enveloppé d’un drapeau des Etats-Unis sur ses épaules. Les noms des victimes des attentats du 11 septembre défilent derrière les membres de U2. Les projecteurs du Superdome en Nouvelle-Orléans s’éteignent à la fin de la chanson Where the streets have no name. Les adultes autour de moi sont visiblement émus. Je lève la tête à ma droite. Mon père est au bord des larmes. Encore une fois, je suis trop jeune pour véritablement comprendre ce qui se passe vraiment, bien que les attentats du 11 septembre m’aient profondément marqué en tant qu’enfant. Je passe rapidement d’une émotion à l’autre. Celle de devoir rentrer à la maison contre mon gré succède à la stupéfaction de voir des hommes adultes incapables de prononcer le moindre mot pendant de longues minutes. J’attends le moment fatidique. Mais mon père ne bouge pas de sa chaise. Pendant la pause publicitaire, il retrouve la voix et se met à discuter avec quelqu’un près de lui. Mon père n’est le plus le même homme.
Le match est sur le point de reprendre et je suis toujours là, dans la maison de Shane et Derek. À ce moment-là, je me dis que mon père n’a pas oublié. D’ici une minute ou deux, il me tendra mon manteau d’hiver et je devrai attendre à demain pour connaître le vainqueur du Super Bowl XXXVI. Et puis cinq minutes passent. Mon père, parti un moment aux toilettes, revient s’asseoir à sa place désignée. Les Rams viennent de dégager le ballon en amorce de la deuxième demie et je suis témoin de la chose. C’est alors que je décide de me retourner et de fixer mon père droit dans les yeux, de lui envoyer un regard signifiant «Mais que se passe-t-il ? Qui es-tu ?». Je n’oublierai jamais son signe de tête approbatif, ce geste qui, d’une certaine manière, me sortait de l’enfance, l’espace de quelques heures. Pour la première fois de ma vie, je serais témoin d’une conquête du trophée Vince Lombardi. Et la nouvelle équipe de mon cœur mène 14-3.
Mais les choses se sont rapidement corsées. Les Rams de Kurt Warner – la légende jamais repêchée ayant conduit les Rams à leur seule conquête du Super Bowl, deux ans plus tôt – ont réalisé la remontée tant attendue, pour porter la marque à 17-17. Et avec 1 minutes et 30 secondes à faire au quatrième quart, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre reprenaient le ballon. Après une brève course de Troy Brown avortée à la ligne de 18, nous avons vite compris que Bill Belichick et Tom Brady n’avaient pas l’intention de provoquer la première prolongation dans l’histoire du Super Bowl. Cela se produirait quinze ans plus tard. En fait, les deux hommes n’avaient qu’un seul objectif en tête : se mettre minimalement en position d’effectuer un botté de placement qui leur permettrait de se sauver avec le Premier trophée Lombardi de l’histoire de cette franchise. Une franchise qui, jusqu’à ce soir, n’avaient connu que l’humiliation et deux défaites écrasantes au Super Bowl de 1986, face aux Bears de Chicago menés par Mike Ditka et Buddy Ryan. Sans oublier celui de 1997, avec Bills Parcells comme entraîneur-chef des Patriots, contre les Packers de Brett Favre. Au cours de la prochaine minute, des décennies de blagues prévisibles à l’endroit des Patriots – et répétées jusqu’à l’amnésie – pouvaient se rédimer par le résultat d’une dizaine de passes bien acheminées par Brady et un botté. Mais encore fallait-il y arriver. La légende du Comeback Kid n’existait pas encore. Elle n’en était qu’à ses premiers balbutiements, à son premier chapitre. Personne n’aurait pu prédire que nous assistions à la naissance de la légende de Tom Brady, le plus grand joueur de football dans l’histoire de la NFL. Et comme tant d’autres, j’étais là. Perdu au cœur de l’insignifiance du présent et de l’ivresse de la victoire imminente.
Tout au long de cette dernière drive, le commentateur vedette John Madden n’a cessé de critiquer la décision de Bill Belichick de prendre ce haut-risque en ne forçant pas la tenue d’un quart supplémentaire. Mais la défensive éreintée des Rams fut incapable de contrer les petites passes foudroyantes de Tom Brady. Une passe à la fois, rien d’extravaguant. Telle fut la clé de cette montée historique du terrain. Déjà, nous pouvions voir de quel bois se chauffait Tom Brady à 23 ans. Plus le bois brûle, meilleur il est. Plus les passes sont d’une précision chirurgicale et plus l’intensité de son regard s’accentue. Son hurlement avant la remise du ballon atteint des décibels de détermination qui ne s’entendent que lors des matchs de championnat. Et 7 secondes avant la fin du quatrième quart, les Patriots se retrouvaient en position de gagner le match par un botté de placement. Après les Rams sur les lignes de côtés avec leur tête d’enterrement, même John Madden s’avouait vaincu : «What Tom Brady just did gives me goosebumps». Ensuite, comme des millions de nord-américains au même moment, j’ai vu Adam Vinatieri réalisé le botté de placement le plus célèbre de l’histoire du Super Bowl. Alors que Bill Belichick sautait dans les airs, mon père me prit dans ses bras en gloussant d’un rire fou, comme lorsque les Expos de Montréal remportaient un match en prolongation. Mon père aimait donc les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ? Mais comment avait-il pu développer une telle passion l’espace d’un seul match ?
Des années plus tard, j’appris que mon grand-père paternel, décédé deux ans plus tôt, fut l’un des rares québécois de son temps à s’amouracher des misérables Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1970, à l’époque où Jean Séguin et Raymond Lebrun décrivaient les matchs de la NFL sur les ondes de Radio-Canada. J’ai alors compris la fébrilité mystérieuse de mon père, quelques heures avant le début du Super Bowl XXXVI : l’équipe de son père avait la chance de remporter son premier Super Bowl et ce match prenait l’apparence d’une rencontre entre les vivants et les morts. J’imagine que bien des fils orphelins se retrouvèrent dans une situation semblable lorsque les Cubs gagnèrent la série mondiale en 2016. Qu’ils soient vivants ou morts, présents ou absents, on célèbre toujours les grands moments d’un sport avec ceux-celles qui nous ont initié à ses rudiments. Une conquête de championnat, bien avant la célébration des exploits d’une équipe adorée, constitue un moment de gratitude envers ceux qui l’ont rendu possible. Les championnats – qu’ils soient répétés ou non, cela n’a pas d’importance – sont des chemins souvent bifurqués par la malchance et les mauvaises décisions d’entraîneurs. Les championnats constituent des routes accidentées par des années de sècheresse et des ventes de feu motivées par le désespoir ou le manque d’argent – ce qui vient souvent ensemble –, où seuls les plus fidèles et les plus amoureux de leur équipe sont appelés à survivre, qu’ils soient vivants ou morts. Mais il existe une loi protégeant ceux qui ont payé ce chemin de leur propre vie : ce sont toujours les morts et les absents qui soulèvent les trophées en premier.
En octobre 2008, en sortant d’un cours au CÉGEP, je reçu un coup de téléphone de ma mère m’annonçant le décès de Michel, le père de mes amis d’enfance Shane et Derek. Après une récidive d’un cancer, Michel perdait la vie dans la mi-quarantaine. Je n’avais pas croisé l’homme depuis des années. En fait, pour des raisons qui m’échappent, mon père et moi ne sommes jamais retournés à une soirée de Super Bowl chez Michel, après la victoire des Patriots. Mais chaque année quand le temps du football revient, à l’automne, je pense à lui. Avant chaque Super Bowl, je pense à lui. Car, si je suis devenu un geek du football, c’est grâce à Michel. Et quand en octobre dernier, j’ai mis les pieds pour la première fois dans un stade de la NFL, le Gilette Stadium de mes Patriots, je me suis recueilli sur une rambarde du stade, devant les cinq banderoles de championnat des Patriots, pour lui dire «Merci, Michel». Comme Michel était un partisan indéfectible des Cowboys de Dallas, j’ignore s’il avait joint la détestation généralisée des amateurs de football nord-américains envers les Patriots. Celle-ci n’était pas encore aussi vive quelques années avant sa mort, mais j’ai pu imaginer son rire franc quand j’ai franchi les tourniquets du Gilette Stadium. Ce même rire que nous pouvions entendre quand Derek frappait un coup sûr important au champ gauche. Car, Michel était aussi mon coach au baseball. Mon père et lui nous avaient conduit à une saison parfaite – l’année où les Patriots ont remporté leur premier Super Bowl – qui s’était conclue par une défaite crève-cœur contre Marieville en finale locale. Après cette défaite, nous nous sommes revus lors de la soirée du Super Bowl XXXVI . À quelques reprises par la suite, sans plus.
Voilà, l’histoire se répète encore une fois. J’ai maintenant 26 ans. Je suis un partisan maladif des Patriots depuis dix-sept ans et, dans moins de deux semaines, ils auront peut-être la chance de remporter le sixième Super Bowl de leur histoire, tous obtenus au cours de l’ère «Belichick-Brady». Et, croyez-le ou non, il s’agira du premier Super Bowl que je regarderai en compagnie de mon père, depuis la victoire de Brady face aux Rams, le 3 février 2002. J’étais toujours avec des amis, lors des quatre autres conquêtes. Il ne faut jamais faire preuve d’outrecuidance, mais quelque chose me laisse croire que la boucle se bouclera le 4 février 2018, que les Patriots gagnent ou pas le trophée Lombardi. Avec les départs annoncés de Matt Patricia et de Josh McDaniels, il s’agira vraisemblablement du dernier Super Bowl pour le tandem Belichick-Brady. Cette saison entière fut traversée par un sentiment de dernière fois. Et pour cette raison, plus tôt cette année, nous avons réaliser un rêve en nous achetant des billets pour assister à un match de notre club, à Foxborough. Je n’oublierai jamais ce moment, le jour de la Saint-Jean, sur le bord d’une plage du Maine, quand ma mère, probablement fatiguée de nous entendre raconter la remontée historique du Super Bowl 51 pour une millième fois, nous proposa cette idée complètement folle : « Si votre Tom est sur le point de prendre sa retraite, comme vous le dites, pourquoi n’iriez-vous pas voir un match des Patriots, cette année ?». Elle ne nous l’a pas dit deux fois. Dès la journée d’ouverture des billets vendus au public, nous avons mis la main sur une paire de billets pour un match des Patriots face aux Panthers de la Caroline et leur quart-arrière, le joueur le plus détestable de l’histoire de la NFL : Cam Newton.
Les mois d’attente avant le match furent extrêmement pénibles et enivrants à la fois. Lors des trois premiers matchs de la saison, je dus vivre avec la crainte que Tom Brady se blesse et que je ne puisse jamais le voir jouer en direct d’un stade de son vivant. Finalement, le 1er octobre 2017, mon père et moi étions au Gillette Stadium, trois heures d’avance. Nous sommes passés devant le Tailgate, où, tous les dimanches, se rassemblent des centaines de pickups chargés de fours BBQ et de chaises pliantes décorées aux couleurs des Patriots. De gigantesques haut-parleurs crachaient le classique des avants-matchs sportifs, Don’t Stop Believing de Journey, alors que nous avancions vers le stade des champions en titre. Jamais, je n’avais vu mon père ressembler autant à un enfant. Sa tête bougeait dans tous les sens et il ne cessait de s’exclamer devant la monumentalité presque sacrale des lieux. Mon père n’en croyait pas ses yeux. Et moi non plus. Pour en avoir parlé avec plusieurs de mes compatriotes, un québécois qui se rend au Gilette Stadium se retrouve dans un non-lieu entre le rêve et la réalité. Et le souvenir qu’il en garde s’apparente justement à celui d’un rêve éveillé, d’où l’importance de recueillir un nombre important de photographies pouvant attester de la véracité de ces souvenirs. Et pour ajouter quelques fantômes à ce rêve éveillé, nous avons visiter le Musée des Patriots où se retrouvent la plupart des artefacts importants dans l’histoire de l’équipe : trophées Vince Lombardi, les trophées de MVP du Super Bowl de Tom Brady, des uniformes portés lors de matchs historiques de l’ère «Belichick-Brady», une salle consacrée aux origines du football américain qui est né en Nouvelle-Angleterre sous le nom de The Boston Game, les premiers uniformes portés par les Boston Patriots en 1960, dont celui d’un joueur d’origine franco-américaine, Lennie Saint-Jean surnommé «Boston Strongboy» . L’un des nôtres, égaré depuis plus d’un siècle dans les terres de la Nouvelle-Angleterre, avait lui aussi abouti dans la petite ville de Foxborough, au poste d’ailier défensif pour les Patriots. Nous n’étions plus seuls.
Voilà pourquoi le fait que les Patriots aient perdu face au joueur que je déteste le plus dans la NFL est sans importance. Même si je me rendais à Foxborough pour la première fois, je me suis retrouvé aux sources de mon enfance. Comme le rappelle Jean-Philippe Toussaint, dans son magnifique livre Football : «Ces peut-être l’enjeu secret de ses lignes, essayer de transformer le football, sa matière vulgaire, grossière et périssable, en une forme immuable, liée aux saisons, à la mélancolie, au temps et à l’enfance. […] Je fais mine d’écrire sur le football, mais j’écris, comme toujours, sur le temps qui passe[1]». Devant un match des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, je suis ce prolongement mélancolique du garçon incapable d’arrêter une balle orange durcie par le froid, un homme inachevé qui se raconte des histoires de sport pour comprendre ce qu’il est devenu, pour éprouver la gratitude profonde à l’endroit des gens à l’origine de cette mémoire personnelle qui n’est rien d’autre que la petite parcelle d’une mémoire qui lui échappe et qu’il tente de retrouver par l’écriture, celle de l’Amérique et de ses travailleurs. Il est facile de réduire un sport robuste comme le football à la violence, à la barbarie maîtrisée du capitalisme et toute la corruption des anciennes valeurs sportives qui l’accompagne. Mais pour moi, ce sport est une cathédrale. Un lieu de recueillement où nous sommes ramenés au caractère impitoyable de l’existence humaine : tout peut arriver et nous, les spectateurs rivés à nos écrans ou à la pelouse du terrain – pour ceux qui ont la chance d’être présents –, sommes impuissants devant l’issue de cette lutte. Ce n’est pas pour rien que l’on prie autant en regardant un match qui peut aller d’un bord comme de l’autre, que le jeu le plus impressionnant que peut réaliser un quart-arrière se nomme un Hail Mary. Mais le football, comme tous les sports, c’est surtout une affaire de mémoire que se transmettent les familles de l’Amérique. Voilà sa véritable beauté. Le football américain, ce sera toujours, pour moi, le souvenir de Michel Grégoire. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ce sera toujours l’enchantement de mon père.
Texte paru initialement sur La Première Ronde.
[1] TOUSSAIN, Jean-Philippe, Football, Paris, Minuit, 2015, pp.42-43
Crédit photo : Sports Illustrated
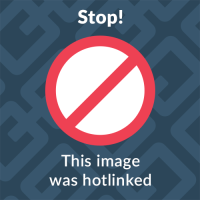








Commentaires
Aucun commentaire